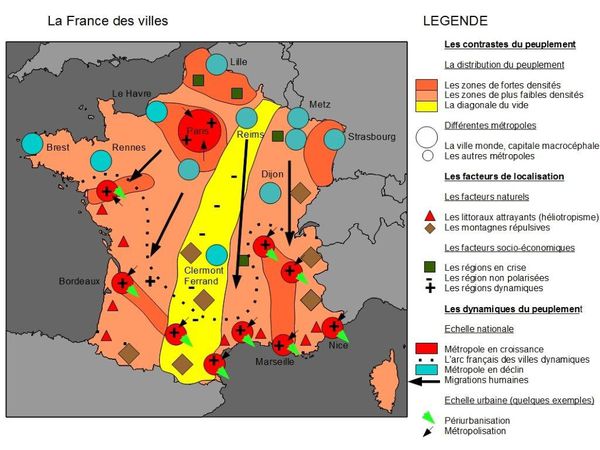Thème II Gérer les ressources terrestres
Chapitre 1 Nourrir les hommes
CONTEXTUALISATION:Comment gérer les ressources agricoles de manière durable pour nourrir 9 milliards d'hommes en 2050?
En 2010, la pop. mondiale est de 6,8 milliards d'habitants; depuis 1950, elle a triplé et elle dépassera sans doute les 9 milliards en 2050.Malgré cette forte augmentation, les hommes sont aujourd'hui mieux nourris qu'auparavant. Cependant, d'importantes inégalités subsistent:13% de l'humanité ne mange pas à sa faim, principalement dans les pays du Sud. Le Brésil, situé en Amérique latine, est un des pays les plus vastes et les plus peuplés de la planète;c'est une puissance émergente, dont le système agricole est ambigu, présentant des caractéristiques des pays du Nord et des pays du Sud.La situation alimentaire et agricole brésilienne reflète, en quelque sorte , la situation alimentaire et agricole à l'échelle mondiale.
La Terre devra nourrir 9 milliards d'hommes dans 40 ans...
Comment l'agriculture arrive-t-elle à nourrir une population croissante?
On étudiera le sujet en répondant aux questions:
-Comment assurer la croissance des productions pour faire face à l'augmentation de la pop.mondiale?
-Comment assurer la sécurité alimentaire en fournissant à tous une alimentation suffisante et de qualité?
-Peut-on développer des agricultures durables?
I. Comment nourrir des hommes toujours plus nombreux?
1.L'ensemble de la pop.mondiale augmente selon des rythmes irréguliers:(Nathan, 2006,p.64,doc.1/2)
-dans les Suds, la croissance de la pop.reste relativement forte(recul de la mortalité, natalité relativement élevée);la croissance démographique devrait se poursuivre pdt encore 50 ans, sur la base actuelle des données
-dans les Nords, croissance démographique faible, car transition démographique achevée
Conséquence:les problèmes alimentaires sont plus graves dans les pays du sud: malnutrition(20% de la pop. dans les Suds.)
2.Depuis 1960, la production agricole croît plus vite que la population(Nathan 2006,doc.1, p.69)
Les facteurs:
-mise en valeur de nouvelles terres par la déforestation(Brésil,Indonésie)
-accroissement des rendements, avec par exemple la Révolution verte en Inde(doc.2b, p.70 et 5 p.71), qui a permis à l'Inde de devenir auto-suffisante.
3.Les populations sont donc mieux nourries, disposant en moyenne de 2800 kilocalories/jour, sauf en Afrique subsaharienne, dont les pays sont en crise alimentaire, avec une disponibilité alimentaire quotidienne inférieure à 2400 voire 2000 kilocalories/hbt.(cf.Magnard 2010 p.72/73 et Nathan 2006, p.66,doc.3)
Cette situation nous rappelle que la sécurité alimentaire n'est pas tjrs assurée.
D'autre part des inégalités d'accès à la nourriture sont flagrantes à ttes les échelles:
-échelle mondiale:les pays du Sud souffrent le plus de sous-alimentation: dans les PMA (Pays les Moins Avancés), la ration alimentaire moyenne s'établit à 2150 kilocalories par jour.
-échelle nationale:12 millions de personnes sous-alimentées au Brésil, soit 6% de la population.(Magnard, p.67, doc.6)
-dans les pays riches:l'insécurité alimentaire est présente; on évalue à une dizaine de millions les personnes qui survivent en situation de sous-alimentation chronique.
Paradoxalement, des millions de personnes souffrent d'obésité, comme en Espagne (10% en France,25%aux États-Unis)(cf.Belin 2010,p.60,doc.4)
4.Que faire?
-étendre les terres cultivables en Afrique et en Amérique latine(90% des réserves en terres cultivables)alors que l'Asie ne dispose que de 10% des réserves en terres cultivables pour 64% pop.mondiale.
-augmenter les rendements par l'utilisation d'engrais et l'irrigation(JLM, 2006,p.65)
La croissance des productions a permis d'améliorer la sécurité alimentaire depuis 50 ans( productions de céréales-blé,maïs,riz-qui nourrissent ½ de l'humanité- ont quadruplé depuis 1960), mais celle-ci n'est pas assurée définitivement:il faudra encore doubler d'ici 2050 la prod.alimentaire .
Parviendra-t-on à assurer la sécu.alimentaire?
II. Comment assurer la sécurité alimentaire aujourd'hui et demain?
1.Quelle insécurité alimentaire au Sud?
-2008:émeutes de la faim dans 35 pays(Haïti,Egypte,Indonésie...)liée à la hausse des prix des produits alimentaires
-2010:la Russie suspend ses exportations de blé en raison de la canicule qui provoque un effondrement de ses récoltes.Pour la FAO, organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture, l’interruption par la Russie de ces exportations de céréales crée «une situation sérieuse» sur le marché du blé ; et si la flambée des prix se poursuivait, elle pourrait causer des problèmes de sécurité alimentaire dans les pays pauvres.
Pourtant, il faut fournir à tous une alimentation suffisante en quantité et en qualité.
2.Quelles logiques ont les divers acteurs de l'agriculture face à cette nécessité?
a)Des États face à l'insécurité alimentaire
-le Mexique a amélioré la situation alimentaire par l'irrigation et l'apport d'engrais(Nathan, 2006,p.65)
-le Brésil a étendu sa superficie cultivable par les fronts pionniers(Nathan, 2006,p.72/73):on parle de solution extensive puis il a développé une agriculture d'exportation intégrée à l'agrobusiness.(cf.étude de cas et Nathan, 2006,p.73, doc.5)
-L'Inde a subventionné des semences améliorées,irrigué les sols et garantit les prix agricoles et soutenu les investissements des agriculteurs;c'est la Révolution verte depuis 1966.
Ce modèle fut un succès ; il s'est diffusé en Indonésie, Thaïlande,Viet-Nam...Chine...(Nathan 2006, p.71,doc.5);ces pays assurent leur sécurité alimentaire.
-La Chine(9% des terres arables ,20% pop.mondiale) achète des terres arables en Afrique et même au Québec:
-Les États-Unis,par les Farm bills et l'UE,avec la PAC, soutiennent leur agriculture. Les pays pauvres ne peuvent pas se permettre de telles dépenses, en particulier en Afrique.
b)Les firmes multinationales
-elles investissent massivement dans la production agricole(ex:Cargill au Brésil(doc.1b,p.74,jlm2006) et Monsanto en Argentine(doc.3, p.75,jlm2006)
Elles pratiquent une agriculture productiviste en développant l'agrobusiness:production agricole de masse intégrée dans des filières agroalimentaires(transformation,conditionnement,transport, distribution...)
-Les FMN achètent des terres arables:on parle d'agriculture « offshore »; acheter des terres arables à l'étranger est devenu un investissement stratégique pour des firmes comme Cargill, ou Monsanto(agro-alimentaire) ou encore Poweo en Ukraine(énergie, bio-carburants)
c)L'inconvénient de ces diverses politiques
la plupart du temps, elles font fi des petits producteurs qui sont évincés de leurs terres par les Etats ou les FMN, ou qui ne sont guère subventionnés comme en Inde avec la Rev.Verte.Il n'y a pas de respect de l'équité sociale.
Au XXI ème siècle, nourrir les hommes c'est répondre à un triple enjeu:produire plus et mieux, favoriser l'équité sociale, tout en préservant les sols et l'eau.
III. Pour développer des agricultures durables, quelles solutions?
Document :L’agriculture peut-elle nourrir le monde ?
Le ralentissement de la progression des rendements est en particulier dû au fait que les agriculteurs ne recherchent plus à présent le rendement maximum mais le rendement optimum (compte-tenu des contraintes environnementales).Il va donc falloir intensifier les productions dans les pays en développement ce qui rend l’irrigation indispensable mais la marge de progression est limitée. A partir des 275 millions d’hectares irrigués actuels (d’où proviennent 40% de la production agricole mondiale) on ne pourra guère aller au delà de 350 millions d’hectares à l’échelle de la Terre compte tenu de la raréfaction des ressources en eau. Il faudra en outre plus de pesticides, d’engrais etc...
Une solution pourrait être l’agriculture biologique mais elle ne représente que 1% des surfaces agricoles planétaires et affiche des rendements de 30 à 40 % inférieurs à l’agriculture traditionnelle. L’agriculture "bio" est cependant une approche intéressante qui peut apporter de bonnes idées à l’agriculture conventionnelle, mais elle ne peut pas nourrir la planète.
Les OGM et les biotechnologies sont d’autres pistes. La surface cultivée en OGM en 2008 représente 125 millions d’hectares sur la planète, surtout répartis dans les deux Amériques, en Chine et en Inde
On a souvent une image négative des OGM, avec de bonnes raisons. On peut avoir des doutes (scientifiquement fondés ?) du point de vue des consommateurs, mais les agriculteurs leur apparaissent de plus en plus favorables sur tous les continents....[...]Mais le problème le plus important ne réside pas dans les techniques de production. Le problème majeur et qui passe avant est celui de l’organisation des agriculteurs. Ils doivent investir en capital et en travail dans la production mais ils ne le feront que s’ils sont assurés d’un retour sur investissement. Il faut le leur garantir d’une manière ou d’une autre et c’est pourquoi de nombreux États ont mis en place des politiques agricoles fortes qui protègent leurs agriculteurs et leur assurent des prix minima. Ces politiques existent dans tous les grands pays producteurs, développés ou émergents mais elles n’existent pas ou trop peu en Afrique.
Jean-Paul Charvet , http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1538 mardi 17 février 2009
1.a)Pourquoi les rendements progressent-ils lentement?les agriculteurs ne recherchent plus à présent le rendement maximum mais le rendement optimum (compte-tenu des contraintes environnementales)
b)Quelles sont les 3 solutions envisagées par l'auteur pour produire plus?
agric.bio,Ogm et biotechno
2.Que représente l'agriculture biologique?
1% des surfaces agricoles planétaires et affiche des rendements de 30 à 40 % inférieurs à l’agriculture traditionnelle.
3.Quel est le problème majeur pour produire de manière équitable?
celui de l’organisation des agriculteurs, qui doivent investir en capital et en travail dans la production mais ne le feront que s’ils sont assurés d’un retour sur investissement.
4.Quel continent semble le plus en retard concernant l'agriculture durable?
L' Afrique, alors que l'Asie applique souvent la Rev.verte.
1.Vers une agriculure durable
->ONU et FAO pour la promotion d'un dvpt agri et rural durable.
Mais aussi, l'homme devra adapter ses habitudes alimentaires, par exemple en consommant moins de protéines animales.
2.Quelles solutions?
a)De nouvelles formes d'agricultures:
-L'agriculture biologique:n'utilise que des apports naturels
MAIS
-couvre moins de 1% de la surface agricole mondiale
-rendements de 30 à 40 % inférieurs à l'agriculture commerciale
-coût de prod. élevé:n'est accessible qu'aux pop. Aisées.
-L'agriculture raisonnée respecte l'environnement en consommant peu de pesticides et d'engrais. Elle cherche à respecter sols et eaux.
b)Débat en classe:Faut-il craindre les OGM ?
Voir Nathan 2006, p.84/85
Travail préparatoire à faire chez soi, en s'appuyant sur le manuel, mais aussi sur une recherche Internet:
une partie des élèves relève les arguments pro-OGM, l'autre les arguments anti-OGM.
Puis débat sur les atouts et les inconvénients des OGM.
->Mise en commun, puis trace écrite:
Les OGM se développent actuellement dans 25 pays, mais, dans certains pays d’Europe, ils sont contestés et en Afrique beaucoup d’Etats n’en ont pas les moyens
C’est une technologie qui a à peine plus de 10 ans. On est passé depuis 1996 d’1.5 millions d’hectares de terres cultivées en OGM à 125 millions aujourd’hui, soit 14 millions d’agriculteurs (dont 13 millions se trouvent dans des pays pauvres) qui y trouvent un intérêt. Aucune innovation technique ne s’est diffusée aussi vite depuis le néolithique, mais les OGM n’apportent rien aux consommateurs et les inquiètent. Pourtant l’Union Européenne qui a un gros déficit pour l’alimentation du bétail, en importe 30 millions de tonnes par an qui sont OGM à 60% pour le Brésil, à 90% pour les USA et à 98% pour l’Argentine. Si on décidait d’arrêter les importations de sojas OGM en Europe et donc les élevages industriels, l’Union Européenne devrait importer ses viandes de volailles et de porc du Brésil et des Etats-Unis ...
c)Changer les habitudes alimentaires
voir débat:Belin 2010, p.78/79
Objectif:
-par une alimentation moins carnée
-par la consommation de produits locaux, comme le réclament les locavores
d)Le problème majeur:l'organisation des agriculteurs
-Les producteurs doivent investir, mais leurs prix doivent être garantis par l'État:cette politique existe dans les pays développés (États-Unis et UE, par ex.), mais aussi dans les pays émergents (cf.Rév.verte en Inde, en s'appuyant sur le doc.5, p.71 du Nathan 2006) Cependant, un continent n'applique guère cette politique:l'Afrique.
-les petits producteurs des pays du Sud sont souvent expulsés de leurs terres par les Etats et les FMN.Pour préserver leurs revenus, se développe le commerce équitable, qui rémunère mieux le petits producteurs respectant l'environnement et ne faisant pas travailler d'enfants; mais ce commerce représente moins de 1% des échanges.
e)D'autres solutions:
-le dvpt de l'aquaculture(cf.Hatier 2010, p.65,doc.5)
-La FAO encourage l'agriculture de conservation pour protéger la terre de l'érosion et l'OMC reconnaît une agriculture de qualité(label ORIGIN)